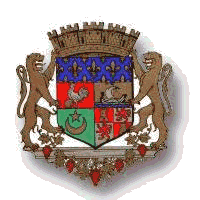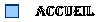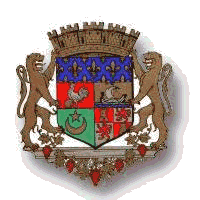|
LES CHEMINS
DE FER EN ALGERIE |
|
A LA MÉMOIRE DE MON GRAND-PÈRE PATERNEL EMPLOYÉ DES
CHEMINS DE FER EN ALGÉRIE FRANCAISE
II faut rappeler ici que les Romains, dont le sens
pratique ne fut Jamais en défaut, avaient, déjà, pressenti le problème de la
circulation et la nécessité de le résoudre, en établissant, en Afrique du Nord,
un réseau considérable de routes dont la principale unissait Carthage a Tanger.
.
Précisons qu'au moment de la pénétration française en
1830, il ne restait guère de ces réseaux routiers que des vestiges, et ne
subsistaient que d'inqualifiables sentiers, propres aux seuls déplacements de
l'homme ou de la bête de somme. Dès les premiers jours, l'administration
militaire, puis l'administration civile se préoccupèrent de cet état des choses.
En 1844, M De Redon eut, le premier, l'idée de la
construction d'une ligne ferrée d'Alger à Blida Plus tard, un groupe de
capitalistes à la tête desquels nous trouvons Lacroix , et aussi des financiers
anglais et allemands, proposa la création d'une ligne de Stora à Philippeville
et Constantine, avec prolongement éventuel jusqu'à Sétif d'une part, et Batna
d'autre part Par ailleurs, Goubé s'inquiétait de différentes lignes convergeant
sur Oran, avec point de départ de l'Hillil, de Mostaganem et de Tlemcen .
Ce n'est qu'en 1854 que Warnier, Ranc, Delavigne, Mac
Carthy et Serpolet, sollicitèrent la concession d'un réseau complet comprenant
la ligne d'Alger à Oran et d'Alger à Constantine,
Une ligne de Constantine à Bône, avec embranchement sur
Philippeville, une ligne de Tlemcen à Mascara par Bel-Abbes, avec prolongement
sur Mostaganem, Ténès et Bougie.
Le général Chaubaud-Latour fut chargé d'examiner ce
dernier projet.
Celui ci avait des vues nettes et un sens pratique "Une
nécessite de l'installation de la colonisation, écrivait-il,
est l'ouverture préalable de bonnes voies de
communication qui permettent aux colons d'exporter leurs produits vers le
littoral Avant l'exécution de ces ouvrages, on ne doit pas, selon nous,
encourager de grandes émigrations de cultivateurs de la Mère patrie vers
l'Algérie ils y épuiseraient leurs ressources, sans pouvoir les reconstituer par
une vente convenable de leurs récoltes.
| Mais les demandes de
concessions affluaient James de Rothschild se mettait sur les rangs II
se proposait d'accepter la concession du réseau entier dans le système
de la loi du 11 juin 1842, c'est-à-dire à la condition que l'Etat ferait
exécuter lui-même les terrassements et les ouvrages d'art et ne
laisserait au concessionnaire que la seule pose des voies
L'empereur Napoléon III, que la question ne laissait pas indiffèrent,
émit a ce sujet, son avis II écrivit Les chemins de fer algériens me
semblent devoir être faits dans 'autres conditions que les chemins de
fer français. Car si d'un côte, dans ma conviction profonde, les chemins
de fer sont un des instruments les plus efficaces de civilisation pour
l'Algérie, de l'autre, le pays n'est pas assez avancé pour faire espérer
dès aujourd'hui aux compagnies un bénéfice raisonnable'. |

Motrice électrique
Inauguration de la ligne électrifie Bône-Tebessa
(desservant les mines de l'Ouenza et du Kouif),
|
En fait, l'empereur envisageait la création d'un réseau partant de
Tlemcen, aboutissant à Philippeville en passant par Oran et Alger et Constantine
avec ligne perpendiculaire à la mer, en direction du sud. L'empereur songeait a
l'armée pour mener à bien les travaux de terrassement, se réservant la décision
pour ce qui concernait une exploitation ultérieure soit par l'état, soit par une
entreprise privée.
Cependant, idées et projets de Napoléon III ne trouvèrent pas un écho
particulièrement favorable au Gouvernement Général de l'Algérie, à la tête
duquel se trouvait le maréchal Randon Le maréchal avait d'autres vues Peut-être
plus étroites et notamment le morcellement des concessions. II y eut polémiques,
discussions et Chabaud-Latour ne fut pas des moindres a se passionner dans le
débat, en fin de compte, une Commission, constituée en 1859 par le ministre de
l'Algérie et des Colonies, se prononça pour la concession à une seule compagnie.
Mais, pour autant, la mise à exécution des travaux n'en traînait pas moins en
longueur L'opinion publique algérienne s'en émut. Elle réclama ses chemins de
fer avec insistance à telle enseigne d'ailleurs, que le maréchal Vaillant jugea
bon de faire adopter par l'empereur le programme d'ensemble élaboré par le
général Chaubaud-Latour. C'est ainsi que, le 9 août 1857, parut au "Moniteur" un
rapport duquel il convient d'extraire, tout au moins, le passage suivant. II
paraît résulter d'études statistiques faites avec soin que, parmi les parcours
d'Algérie, il en est trois principaux, un par province, sur lesquels les
transports en marchandises et en voyageurs suffisent, des ce moment, pour
assurer aux voies ferrées des éléments de vie et de succès. Ces parcours sont
ceux qui se trouvent:
'1° entre Alger, Blida et Amoura, desservant les grands marches arabes de
la plaine du Cheliff,
2° entre Constantine et Philippeville transit commercial le plus fréquent
aujourd’hui,
3° enfin entre Oran et Saint-Denis du Sig, section qui sert a 1 écoulement
des riches produits des pleines du Sig du Tielat et de 1' Eghris.
Ces propositions furent sanctionnées par décret du 8 avril 1857, et afin
de leur donner une valeur matérielle, les travaux du chemin de fer d Alger à
Blida commencèrent 1 année suivante, en 1858. On utilisa, comme 1'avait suggère
l’empereur, la main d' oeuvre militaire. Entre temps, on s occupa de la
concession d exploitation de ce réseau. Un décret du 11 Juillet 1860 approuva la
concession à M Albert Rostand, des Messageries impériales, Jules Gautier,
administrateur des chemins de fer du Dauphine, le comte Branicki, administrateur
du chemin de fer d Orléans, et H Tope, membre du parlement britannique, qui
devinrent les fondateurs et administrateurs de la Compagnie des chemins de fer
algériens. Mais cette compagnie ne put, par la suite, mener son oeuvre dans de
bonnes conditions financières. On envisagea alors de la fusionner avec une
compagnie métropolitaine en l'occurrence, la Compagnie P L M . Cette fusion fut
sanctionnée par un traite en date du 31 mars 1863. Le 1e mai de la même année,
le maréchal Randon approuvait le dit traite et passait avec la Compagnie de la
Méditerranée une nouvelle convention lui concédant, avec la ligne d Alger à
Constantine, celle d Alger à Oran par Blida et Saint Denis du Sig La Compagnie
de la Méditerranée s était engagée à construire les lignes d Alger à Constantine
et d Alger à Oran dans un délai de dix ans La première de ces lignes était
livrée au trafic le1e septembre 1870 , cependant que le tronçon Alger Blida fut
ouvert en 1868. La ligne entière fut exploitée à partir 1° mai 1871. Entre 1863
et 1874 une seule concession, en dehors des principales, fut accordée , celle de
la Compagnie Franco Algérienne pour un tronçon de ligne allant d Arzew à Saida,
avec prolonge ment prévu Jusqu'à Gery ville (29 avril 1874) En 1877, le général
Chanzy gouverneur général de 1 Algérie, concluait avec la Société des
Batignolles une concession des deux lignes de Duvivier a Souk Ahras et a
Sidi-El-Hemissi et de Guelma au Kroubs Ces lignes furent ouvertes respectivement
les 29 Juin 1879 et 30 Juin 1881 d' autre part, selon le décret du 7 mai 1874,
une convention était passée par le département d 'Oran avec M Seignette et Cie
(plus tard remplaces par 1 'Ouest Algérien) pour la concession du chemin de fer
d intérêt local de Sainte Barbe-du-Tlelat à Sidi Bel Abbés (ligne ouverte le 3
mai 1877
En 1875, le gouverneur Chanzy passait une autre convention avec M Joret
pour la ligne de Constantine à Sétif (ligne ouverte le 20 mai 1879) M Joret
passait également convention, le 31 août 1877, avec le département d Alger pour
concession des lignes de Maison Carrée à 1 Aima et à Menerville (lignes ouvertes
le 5 août 1879 et le 25 septembre 1881) D autres concessions eurent lieu par la
suite que nous rappelons pour mémoire Menerville à Tizi Ouzou (ouverture par
sections, de 1866 a 1888) , Batna à Biskra (1" Juillet 1888) , Béni Mançour à
Bougie (24 mars 1889) Ouled Rahmoun à Ain Beida (11 Juillet 1889) Aîn Beida à
Khenchela (10 Juin 1905), etc. Que d'' exploits techniques, que de bravoure.
L’Algérie était entièrement traversée par le réseau ferré.
Lors de la guerre 1939-45, Les Chemins de fer de l'Algérie, assurèrent les
transports de troupes et de matériel des alliés, depuis les ports algériens,
vers Souk Haras et tout près du front des combats.
Puis vinrent les Jours sombres.
On oubliait vite qu outre les machines, le chemin de fer est compose d
hommes qui défendirent souvent au péril de leur vie cette terre qui était la
leur comme Paul François Alaimo, mécanicien de locomotive diesel qui sera cite à
1 ordre de la brigade avec les motifs suivants
--
Documents P.F Alaimo
Conducteur sur la
ligne de la Soummam a assure avec une ténacité et un courage dignes d'éloges la
conduite des trains dans cette région difficile malgré les attentats multiplies
sur la voie ferrée S'est distingue le 23 juillet 1958 dans la région d'Allaghan
lors de l'explosion d'une forte mine détruisant plusieurs wagons, en gardant le
contrôle du train et préservant ainsi de nombreuses vies humaines A contribue
par cet exemple de bravoure au maintien de la ligne en dépit des entreprises
terroristes
Et lorsqu elle apparut au grand Jour la perspective de l'autodétermination
provoqua, dans le monde cheminot, la même implosion que dans l'ensemble de la
communauté pieds noirs.
Quelques uns, fidèles a l'idéal communiste, admirent le principe de
l'indépendance, dut-elle les pousser à l'exil quelques mois plus tard. D'autres,
selon leurs propres fermes, entrèrent en résistance
S'il est difficile de quantifier l'ampleur de l' adhésion des cheminots à
la cause de l'Algérie française, il est indéniable que toutes les couches de la
corporation participèrent à ce combat On peut citer ce fonctionnaire qui
dissimula dans les compartiments moteurs de son diesel telle haute personnalité
contrainte de quitter clandestinement Alger après l'échec du putsch d 'avril
1961 mais aussi, un an plus tard, la mutation précipitée du directeur Jusseau,
embarqué manu- militari dans un avion militaire en partance pour la Métropole,
suite a des faits qui n'ont pu être établis.
Et la tension monta, Jusqu a alimenter l'énergie du désespoir. Avant de
gravir 1 échelle de coupée du bateau certains étaient allés Jusqu'à verser des
seaux entiers de sable dans les réservoirs a gazole de ces locomotives qui
avaient fait leur fierté crédit: Les
chemins de fer de la France d'outre-mer (Éditions La Régordane.